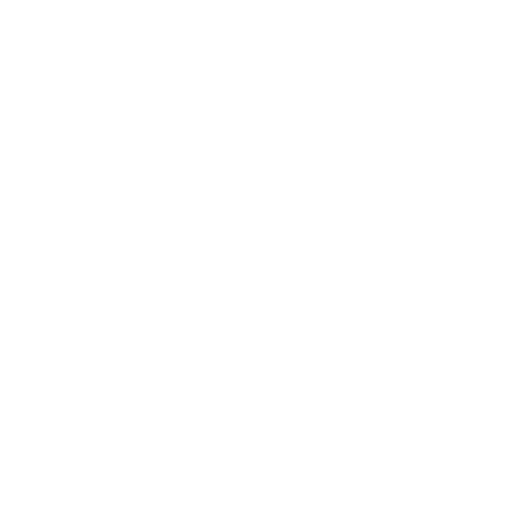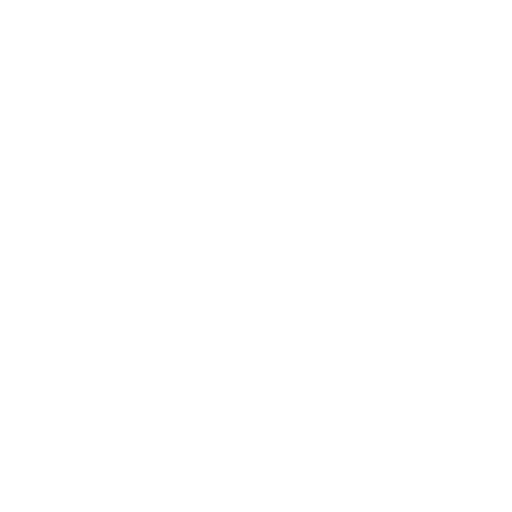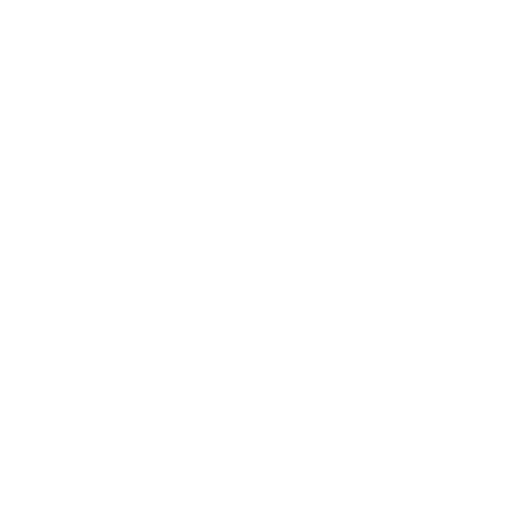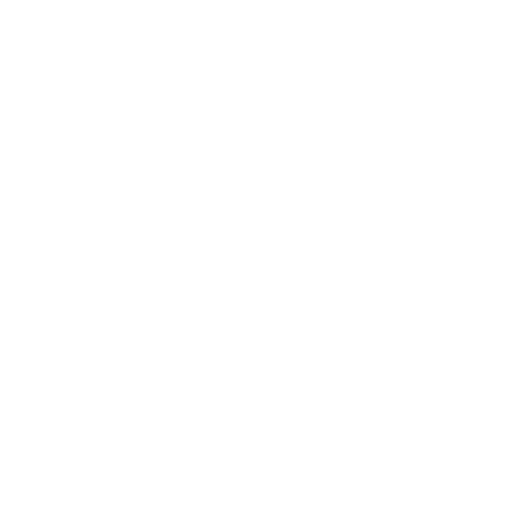17e Dimanche du Temps Ordinaire
27 juillet 2025 – Année C
(Gn 18, 20-32 ; Col 2, 12-14 ; Lc 11, 1-13)
Partages d’Évangile des missionnaires
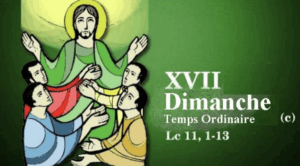
Prier avec persévérance ! C’est la leçon essentielle à retenir de ce passage de saint Luc. En effet, tout bon pédagogue sait que l’enseignement par l’exemple est l’un des meilleurs moyens de transmettre une leçon. C’est précisément ce que fait Jésus : Il donne l’exemple de la prière, Il prie. Il enseigne à ses disciples les mots pour prier, et leur montre comment prier à travers une parabole.
En un certain lieu, Jésus était en prière. Le lieu n’est pas précisé, comme pour suggérer que ce qui importe, ce n’est pas l’endroit, mais l’acte même de prier. Jésus prie. Et c’est cela qui attire l’attention de ses compagnons. À la vue de cette prière silencieuse, un des disciples se sent interpellé et lui dit : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l’a appris à ses disciples. » Il est évident que de simples gestes accomplis dans la plus grande discrétion peuvent être l’origine d’un torrent impétueux qui drainerait des cœurs vers une intimité profonde avec Dieu.
Quand vous priez, dites : “Père”. En araméen : Abba, c’est-à-dire petit papa chéri ! Jésus donne, ainsi, à ses disciples le droit de s’adresser à Dieu à la manière dont lui-même, lui parle. Il les fait entrer dans l’intimité profonde qu’Il partage avec son Père. Et, ce faisant, Il les introduit sur le chemin du Royaume, afin que là où Il est, eux aussi soient avec Lui (Jn 17,24).
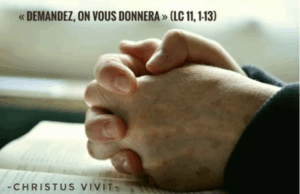
En priant le Notre Père, les disciples d’hier comme d’aujourd’hui sont appelés à entrer dans un dynamisme de communion avec le Père. Mais cette communion verticale avec Dieu ne peut être authentique sans une relation fraternelle avec les autres. En effet, nul ne peut véritablement dire "Père" s’il refuse de dire "frère". Il serait illusoire de s’adresser à Dieu comme à un Père sans reconnaître les autres comme des frères. Dès lors, la prière prend une double dimension : verticale, dans la relation à Dieu, et horizontale, dans l’ouverture à autrui. Dieu n’est réellement mon Père que s’il est notre Père. Faute de quoi, ma prière risque de se refermer sur moi-même et de devenir une illusion spirituelle. Je reprends ici une parole forte de François Varillon : « La prière n’est authentique que si elle est consécration de soi aux autres. » Ainsi comprise, la prière devient à la fois point d’accroche entre le ciel et la terre, point d’ancrage de l’unité chrétienne, et clef de voûte de toute démarche véritablement œcuménique. Elle est le lieu où se noue l’alliance entre Dieu et l’humanité, dans une communion qui ne saurait exclure personne.
Jésus ne nous enseigne pas seulement quoi dire dans la prière, mais aussi comment prier. C’est tout le sens de la parabole de l’ami importun (Lc 11,5-8), qui suit immédiatement le Notre Père. Elle nous invite à prier avec insistance, voire avec audace. Dans ce récit, la demande des « trois pains » fait écho à la requête du pain quotidien dans le Pater (Lc 11,3). Et la réponse, « Ne viens pas m’importuner ! » rappelle la parabole du juge inique (Lc 18,1-8), soulignant la nécessité de persévérer. Le mot grec anaideia, souvent traduit par « sans-gêne », exprime une persistance audacieuse. La leçon est claire : nous pouvons nous adresser à Dieu sans-gêne, avec une confiance absolue en sa bienveillance. C’est cette même audace confiante qui animait Abraham lorsqu’il intercédait pour Sodome (Gn 18,20-32).
« Ne viens pas m’importuner ! » rappelle la parabole du juge inique (Lc 18,1-8), soulignant la nécessité de persévérer. Le mot grec anaideia, souvent traduit par « sans-gêne », exprime une persistance audacieuse. La leçon est claire : nous pouvons nous adresser à Dieu sans-gêne, avec une confiance absolue en sa bienveillance. C’est cette même audace confiante qui animait Abraham lorsqu’il intercédait pour Sodome (Gn 18,20-32).
Demandez, cherchez, frappez : une invitation à une prière persistante et vivante. Une prière constante sans être machinale. Le risque est bien grand de s’enliser dans la routine des mots. Nous oublions souvent que dans la prière, « il vaut mieux avoir un Cœur sans paroles que des paroles sans Cœur. »
P. Jackson Fabius, smm